Nul besoin de la scruter sous un verre grossissant pour faire ressortir les points communs de ma moisson hivernale. Les quatre titres rebondissent du tremplin « réalité » conjuguée sous différentes formes et personnages. J’ai découvert certaines réalités, même sur les planches des bandes dessinées.
« Ma vie en lo-fi » est une invitation à explorer l’univers sonore d’un malentendant, l’auteur lui-même, Simon Labelle. Le deuxième album relate les débuts du cinéma muet « L’apogée du mime », le deuxième tome d’une série avec Philippe Lemieux au texte et Garry au dessin. J’ai ensuite quitté ces plages de légèreté pour plonger au cœur de la société québécoise scrutée sous la loupe d’une ex-réfugiée du Chili, aujourd’hui, professeur de sociologie avec « Là où je me terre » de Caroline Dawson. Ce titre est un portrait détaillé et détonnant de la société québécoise.
Je termine gravement avec « La saison des armes » de Ginette Durand-Brault qui a braqué son faisceau lumineux sur les prémisses du mouvement nationaliste au Québec. Une révolution pas si tranquille prend vie sous sa plume scrutatrice et scrupuleusement conforme d’ex-juriste.
Ma vie en lo-fi de Simon Labelle — Mécanique Générale
L’histoire se présente sous forme de bandes dessinées, et cela aurait pu ne pas l’être. Je trouve audacieux — et très à propos — d’explorer le monde des malentendants en nous en mettant plein la vue. Simon Labelle écrit et dessine, se mettant au service de nul autre que lui-même qui est malentendant.
Disons qu’avant qu’un ORL le diagnostique « apparareillable » (mot inventé prélevé à même l’album), c’est-à-dire assez sourd pour être éligible à porter un appareil auditif, l’homme a vécu des difficultés à communiquer, ce qu’il nous relate incident par incident, page par page, gag par gag. Nous avons droit à une incursion dans son univers sonore où les ondes peuvent se brouiller, d’acouphènes entre autres.
On le retrouve dans plusieurs situations quotidiennes, talentueusement campées, tentant de faire ressortir la loufoquerie. Les péripéties de l’auteur sont tirées de situations « avant » l’appareillage, « après » et « pendant ». Une prothèse auditive est en cela différente d’une prothèse buccale qu’elle se retire de l’oreille sans donner des hauts de cœur à son prochain! Donc, j’imagine que le protagoniste a testé le « avec » et le « sans » et a voulu partager ces sensations peu communes avec nous.
Si vous êtes encore à vous demander s’il y a juste vous qui ne connaissez pas l’expression « Lo-Fi », je vous rassure, l’auteur s’est permis cette fantaisie de langage en pensant au « Hi-Fi », signifiant la haute fidélité. Les sons lui arrivaient sous une basse fidélité avant de recevoir son appareil. Il en a souffert et a su tourner certaines situations en dérision.
Une sensation d’isolement se dégage des pages noircies aux traits grossiers et épurés, ce qui est réussi puisque son handicap l’isole. J’ai apprécié l’assurance du trait, particulièrement les ovales de sa figure à lunettes qui revient continuellement. Même sans ses yeux, il est clair qu’il voit bien! C’est une fantaisie du dessinateur de laisser tomber l’attribut « yeux », autrement dit, un faible pourcentage de figures a reçu des yeux dans cette bande dessinée en noir et blanc.
Les personnages sont bien articulés, le mouvement des corps est assez éloquent pour que la voyeuse que je suis ne conteste pas cette absence de regards. J’ai aimé et trouvé que les traits épurés me ramenaient au style Rabagliati. C’est évidemment à prendre comme un compliment. Ma frustration, car j’en ai éprouvé une, cible le survol trop expéditif des situations. Je suis restée sur ma faim, j’en aurais pris encore plus, en pages et en profondeur.

L’Histoire du cinéma en BD – tome 2 : L’apogée du mime. Texte : Philippe Lemieux. Dessin : Garry – Éditions Michel Quintin

Cet album coloré de format classique du 9e art nous invite à explorer le 7e art. Qui de mieux qu’un professeur de cinéma, Philippe Lemieux, pour nous offrir une telle série? Je le souligne, ce titre est le tome 2 d’une série couvrant l’histoire du cinéma (à combien de tomes se rendront-ils?). J’aime apprendre en m’amusant et c’est ce que cette bande dessinée m’a permis.
Deux mordus de cinéma guident notre apprentissage et ces jeunes, Philippe et Mélanie, apparaissent au gré de l’inspiration de l’auteur, c’est-à-dire à n’importe quelle case. Ils rajoutent leur grain de sel, parfois, la salière au complet. Ils mettent particulièrement en lumière la carrière prolifique d’un homme né à Richmond au Québec et déménagé à 14 ans aux États-Unis et j’ai nommé : Mack Sennett. Il finira par atteindre ses rêves, en 1912, lorsqu’il inaugure les studios Keystone à Edendale en Californie.
C’est par cet initiateur de vent de fraicheur que la comédie entre dans les mœurs américaines. Il faut savoir que jusqu’à cette année, il se faisait principalement des films sérieux. Ce serait la muse de Mack Sennett qui aurait insisté pour qu’il rencontre l’énergumène, Charlie Chaplin. Pourtant, on voit dans une des cases, le réalisateur dire que Chaplin (jalousie) n’a pas beaucoup de talent…
Malgré son opinion, il mettra en lumière le rigolo personnage, n’hésitant pas à lui enseigner les rudiments du métier. À noter que Charlie Chaplin deviendra rapidement son propre réalisateur. Nous avons droit à des extraits de films, des anecdotes de tournage, des manières de travailler des réalisateurs du cinéma muet. Les propos restent concis, mais assez loquaces pour qu’on apprenne que, grâce au Québécois, Mack Sennett, un premier studio est fondé, où le cinéma burlesque prendra de l’expansion, qu’il découvrira Charlie Chaplin et qu’il financera les fameuses lettres iconiques « H.o.l.l.y.w.o.o.d. » sur la colline de Los Angeles. On va se le dire, ce n’est pas rien que de l’apprendre dans une bande dessinée.
Je m’en voudrais de ne pas faire allusion au dessin qui m’est apparu clair, vibrant, dynamique et… chevelu! Les chevelures sont abondantes à souhait et les yeux globuleux et un peu exorbités de la tête. Un peu à la manière Garfield. C’est un style et il faut s’arrêter pour le constater, car cela semble tout à fait « normal » dans le contexte. L’album s’adresse aux jeunes de 10 ans et plus, à consommer sans façon et avec appétit.

Là où je me terre de Caroline Dawson – Les éditions du remue-ménage

Voici un roman qui n’est pas passé inaperçu. Caroline Dawson en est peut-être elle-même surprise, le roman l’ayant dépassé, devenu plus grand qu’elle. Lorsqu’on écrit sur soi, en l’occurrence son arrivée au Québec à sept ans, cet âge où l’on suit ses parents les yeux fermés et le cœur ouvert, on n’évalue pas encore la difficulté d’intégration. On se lance, on met toute son énergie à l’adaptation, à l’assimilation, à la nouvelle civilisation que l’on doit faire sienne.
Les Québécois accueillent à bras ouverts, on n’a qu’à penser à Kim Thùy qui a pris d’assaut les mots pour nous chanter sa reconnaissance. Malgré certaines similitudes entre les deux arrivantes, il est passionnant de découvrir un nouveau regard qui part de l’extérieur vers l’intérieur. L’autrice décrit avec acuité et lucidité cet air que l’on respire tous les jours et dont on ne prend pas toujours la juste mesure. Elle a opté pour de brefs chapitres qui mettent en relief des anecdotes pratico pratiques. Un enfant scrute la lettre, non pas l’esprit de la lettre, en plaçant son attention sur du concret.
Les anecdotes de l’autrice ont macéré quelques décennies, baignant dans sa mémoire sensitive, il en reste un peu de candeur, mais ce n’est pas l’ingrédient principal. Même si l’autrice a pris garde de ne pas rédiger une analyse, son esprit critique ressort comme un réflexe. C’est inhérent à sa fibre faite femme. Je me dois de révéler ici que Caroline Dawson a une formation en sociologie, elle l’enseigne même! Imaginez l’acuité du regard posé sur nos institutions, nos mœurs, nos habitudes, nos réflexes, nos traditions, nos manies. Sur tout! Ou à peu près.
La substance s’avale goulument au cœur friand d’accueillir l’autre dans sa différence. J’ai tiré la conclusion que ce qui nous semble anodin peut se vivre comme un drame pour un nouvel arrivant. J’irai jusqu’à déclarer que cette sensibilité exacerbée pourrait se transformer en susceptibilité. Ce n’est pas le cas ici, on sent toute la bienveillance du regard porté à la société d’accueil et à ses parents qui font le pont.
Un livre doté d’un esprit aussi critique (re)met les pendules à l’heure : ce n’est absolument pas évident d’arriver dans un pays qui parle une langue indéchiffrable. Les émotions en ressortent vives, intenses, puisque les mots ne sont pas encore là pour les tempérer. Je trouve le titre des plus judicieux… pour le son « taire ». C’est tellement à propos, ne taisons jamais qui nous sommes ou qui nous tentons d’être, nous recevrons l’autre avec encore plus de conscience et d’à-propos. Il y a là matière à réflexion.

La saison des armes de Ginette Durand-Brault – Édition Druide
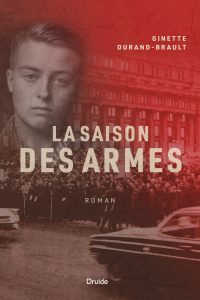
Il fallait du courage pour fouiller ce remous peu glorieux des années soixante, lorsque la nation québécoise a commencé à s’affirmer. Le personnage principal, le journaliste, Denis Deschamps a couvert des révolutions ailleurs, mais jamais chez lui, au Québec. Le goût de revenir dans ses quartiers coïncide avec le réveil du nationalisme. Dès son retour, il se relie à plusieurs connaissances dont certaines sont impatientes, pressées, colériques : on doit brasser la cage pour réveiller l’ardeur patriotique.
Le journaliste maintenant professeur se faufile entre les milieux indépendantistes, les fréquente, y braque un éclairage suffisant pour qu’on tente de se démêler dans ces groupes initiateurs du mouvement indépendantiste. Certains radicaux abordent la violence comme incontournable à qui veut s’affirmer. Les grands moyens, comme la pose de bombes, ne sont pas à négliger et les consciences sont élastiques lorsqu’il s’agit de défendre l’idée de la séparation.
J’apprécie chez dame Durand-Brault son respect des faits réels qu’elle ne contourne jamais, qu’elle relate même posément. Nous n’avons pas l’impression d’une lecture vaine, mais plutôt d’un apprentissage des évènements du passé qui débouche sur notre présent. J’ai cependant éprouvé une certaine difficulté à m’accrocher à un fil conducteur, et même au personnage principal, Denis Deschamps. Je précise ma perplexité devant la neutralité du ton, surtout lorsqu’il est question d’actes violents perpétrés sur des personnes qui ne partagent tout simplement pas notre vision.
J’en ai conclu que nous sommes invités à regarder par la fenêtre panoramique de cette saga des années soixante sans prendre parti, ce qui n’est pas toujours évident. Ces pages d’histoire m’apparaissent laborieusement instructives. Il n’est pas toujours facile de respecter l’Histoire avec son grand H, tout en conservant un rythme soutenu.

À lire aussi :













